- Accueil
- Thématiques
- Littérature
- Littérature ancienne
- Parole et geste dans la tragédie grecque
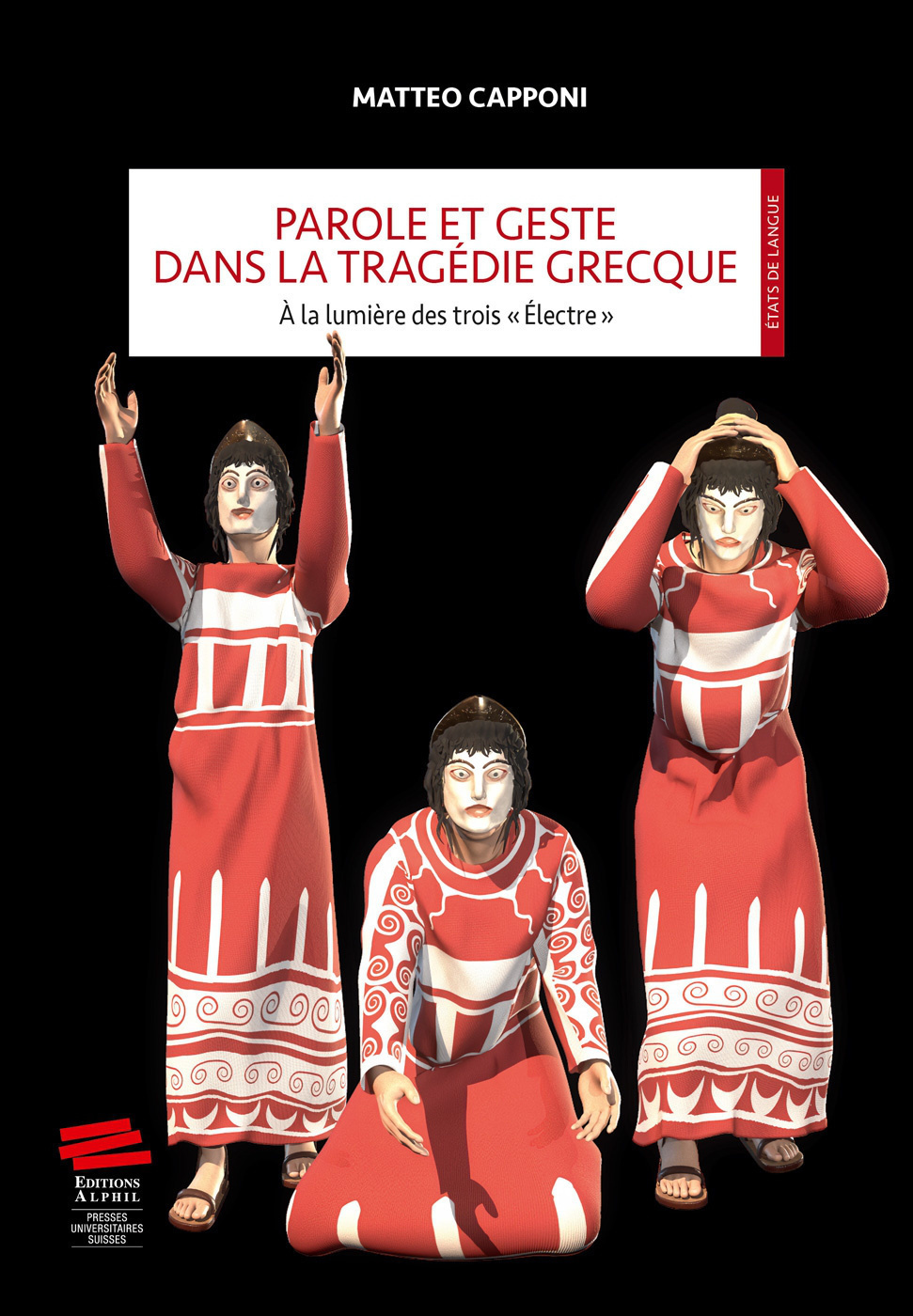
Parole et geste dans la tragédie grecque
| Crédit | |
| Date de première publication du titre | 14 janvier 2021 |
| ISBN | 9782889303267 |
| EAN-13 | 9782889303267 |
| Référence | 124558-87 |
| Nombre de pages de contenu principal | 200 |
| Format | 0 x 0 x 0 cm |
| Poids | 300 g |
Avant-propos................................................................................................ 9
Préface............................................................................................................ 11
Introduction................................................................................................. 19
Agir avec des mots....................................................................................... 21
Le théâtre, là où les mots se font gestes...................................................... 23
Les " trois Électre "...................................................................................... 24
Ritualité.................................................................................................... 26
Forme de l'énoncé................................................................................... 27
Skhêma du corps et du langage............................................................... 28
Gestualité................................................................................................. 29
Les correspondances entre geste et parole................................................... 29
Nota bene..................................................................................................... 32
Chapitre 1. Rites de parole et actes de langage............................ 35
1.1. Pratiques antiques................................................................................. 36
Malédiction !............................................................................................. 36
Appel à témoin......................................................................................... 40
Une tentative de classification................................................................. 43
Rites de parole… et de gestes.................................................................. 56
1.2. Les voies de la linguistique contemporaine.......................................... 65
Les actes de langage................................................................................ 65
Énonciation et " performance "................................................................ 67
Une terminologie contemporaine............................................................. 70
Le langage non verbal............................................................................. 73
1.3. Trois critères d'analyse......................................................................... 76
Ritualité, forme, gestualité....................................................................... 82
Chapitre 2. ???µa. L'action rituelle de la parole....................... 83
2.1. La double énonciation théâtrale............................................................ 83
2.2. Eschyle, un théâtre rituel ?.................................................................... 88
Le kommos comme rite funéraire ?......................................................... 88
Le statut des Choéphores......................................................................... 90
Les termes langagiers autoréférentiels.................................................... 91
2.3. Le choeur en action................................................................................ 92
Un choeur qui agit.................................................................................... 92
Un choeur complice.................................................................................. 97
2.4. Les protagonistes en action................................................................... 101
Une succession de rites langagiers.......................................................... 102
Le retour du prince.................................................................................. 104
Entrée d'Électre et des porteuses d'eau.................................................. 110
Un péan pour la fin (v. 150-166)............................................................. 120
2.5. Le kommos............................................................................................ 124
Un rite qui se cherche (v. 315-339)......................................................... 126
La " musique " du kommos...................................................................... 131
La structure du kommos.......................................................................... 133
Une prière prosaïque............................................................................... 150
Le kommos est-il efficace ?...................................................................... 154
2.6. Comparaison avec Sophocle et Euripide.............................................. 156
La prière avant le meurtre....................................................................... 159
Fonction de la parodos............................................................................. 163
2.7. Synthèse : d'un rite à l'autre................................................................. 168
Chapitre 3. ?????. Manière de dire, manière de voir...................... 171
3.1. Formes d'énoncés................................................................................. 174
Voir et entendre........................................................................................ 174
Des unités de composition....................................................................... 175
3.2. Métaphores visuelles chez Aristote...................................................... 176
Lexis rhétorique et lexis poétique........................................................... 177
Lexis eiromenê et lexis katestrammenê................................................... 181
Lexis avec ou sans périodes.................................................................... 183
La métaphore de la course....................................................................... 187
3.3. Le " poétique " dans la Poétique........................................................... 194
La lexis dans la Poétique......................................................................... 196
Contre la théorie de " l'écart "................................................................ 204
3.4. Forme, figure, skhêma........................................................................... 207
Du mot à la forme.................................................................................... 207
Les skhêmata............................................................................................ 208
Modalités du discours.............................................................................. 218
Jouer les skhêmata................................................................................... 224
Skhêma comme concept opératoire......................................................... 227
Chapitre 4. S??µa. Forme du langage et du corps......................... 233
4.1. Sophocle, la forme mesurée et parfaite ?.............................................. 233
Le deuil perpétué...................................................................................... 233
Le " fait " d'Électre.................................................................................. 235
4.2. Entendre Électre.................................................................................... 239
La lamentation initiale d'Électre (Soph. Él. 86-120).............................. 240
Clause et période, kôlon et skhêma......................................................... 245
Découpage par unités.............................................................................. 249
Un skhêma du corps et de la voix............................................................ 254
Donner à voir les skhêmata..................................................................... 259
Les skhêmata dans le texte (Soph. Él. 86-120)........................................ 261
L'acteur comme révélateur de formes..................................................... 267
4.3. Électre dans l'agôn............................................................................... 269
Agôn entre Électre et Chrysothémis (Soph. Él. 328-348)....................... 270
4.4. Comparaison avec Eschyle et Euripide................................................ 279
Entrée en scène d'Électre........................................................................ 279
4.5. Synthèse................................................................................................ 287
Chapitre 5. ????s??. Le geste joint à la parole............................... 291
5.1. Euripide, adepte du réalisme et des gestes ?......................................... 291
Un théâtre du corps................................................................................. 292
Aspects techniques de la gestualité.......................................................... 294
Le cas Euripide........................................................................................ 300
5.2. Les gestes dans les mots....................................................................... 306
Trois manières de " jouer " des libations................................................. 306
Monodie d'Électre en porteuse d'eau (Eur. Él. 112-166)....................... 310
Gestes dansés et gestes joués................................................................... 313
Premier contact........................................................................................ 317
5.3. Retrouvailles et embrassades................................................................ 326
L'étreinte d'Oreste et d'Électre............................................................... 326
L'illusion évolutive................................................................................... 344
Euripide poète de variété......................................................................... 347
Chapitre 6. Conclusion............................................................................. 351
Prendre les gestes au mot............................................................................. 351
Une clef d'analyse indigène, polymodale et polyvalente............................ 354
Bibliographie................................................................................................ 357
Recommandations
Inscrivez-vous à notre newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les actualités, les mises à jour et les derniers projets sur lesquels nous travaillons.
