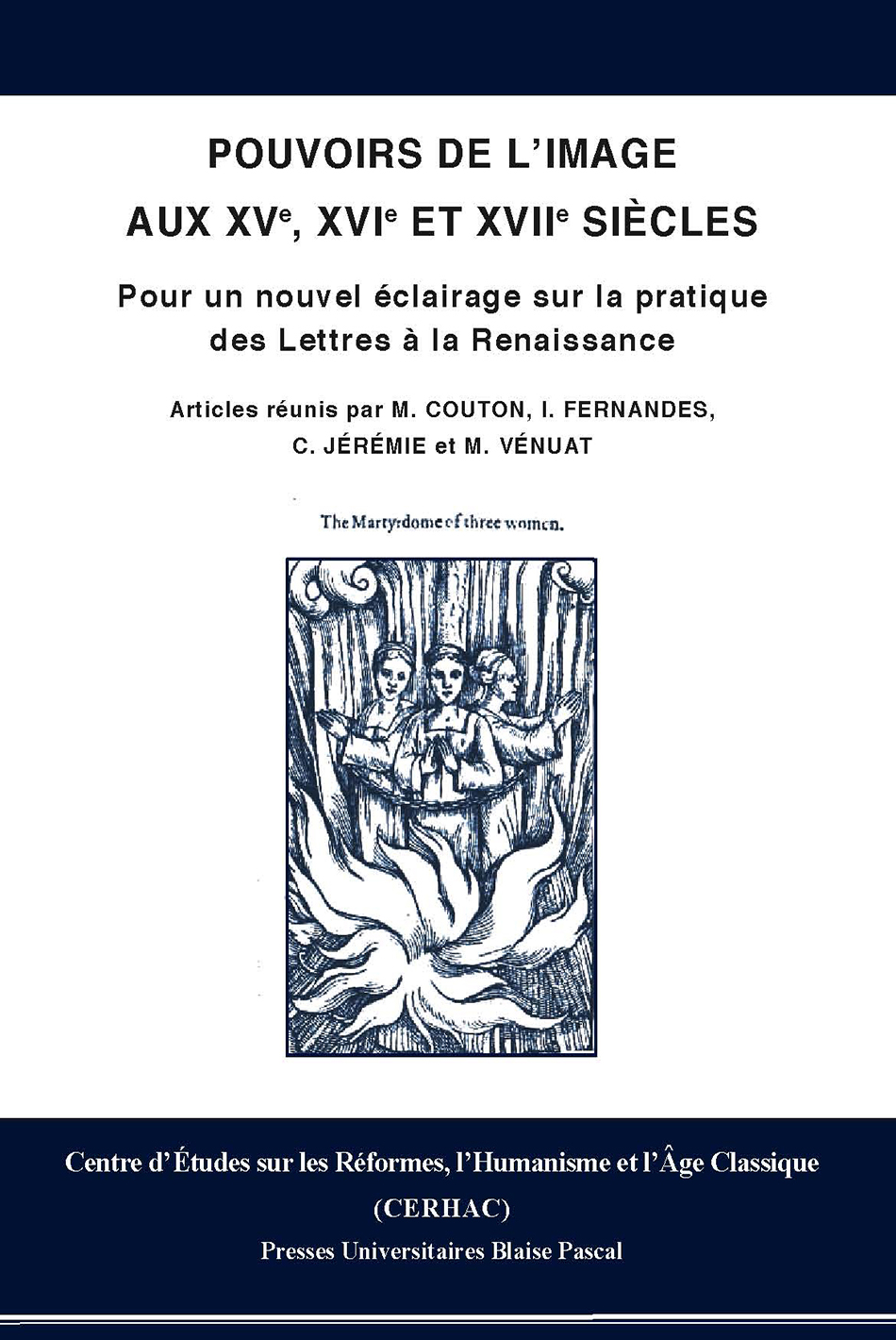
Pouvoirs de l'image aux 15e, 16e et 17e siècles
Marie COUTON,Isabelle FERNANDES,Christian JÉRÉMIE,Monique VÉNUATRésumé
Les personnes de la Trinité, les saints, les rois, les dieux antiques, les hommes célèbres vivants ou morts, les obscurs, les symboles sacrés ou profanes, pourquoi pouvait-on penser à la Renaissance et à l'Âge Classique que certaines figures n'étaient pas représentables alors que d'autres devaient être offertes en exemple ? Quels modes de représentation semblaient appropriés pour donner l'image de ces différents personnages et de ces objets ? Quels rapports les auteurs et leur public établissaient-ils entre les images immédiates et les images médiatisées par les textes ? Dans les modes visuels comme dans les modes textuels l'image peut remplir des fonctions diverses, elle peut être séduisante ou horrible, utilisée pour la démonstration, l'argumentation, pour une célébra ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
33.00 €
Ajout au panier /
