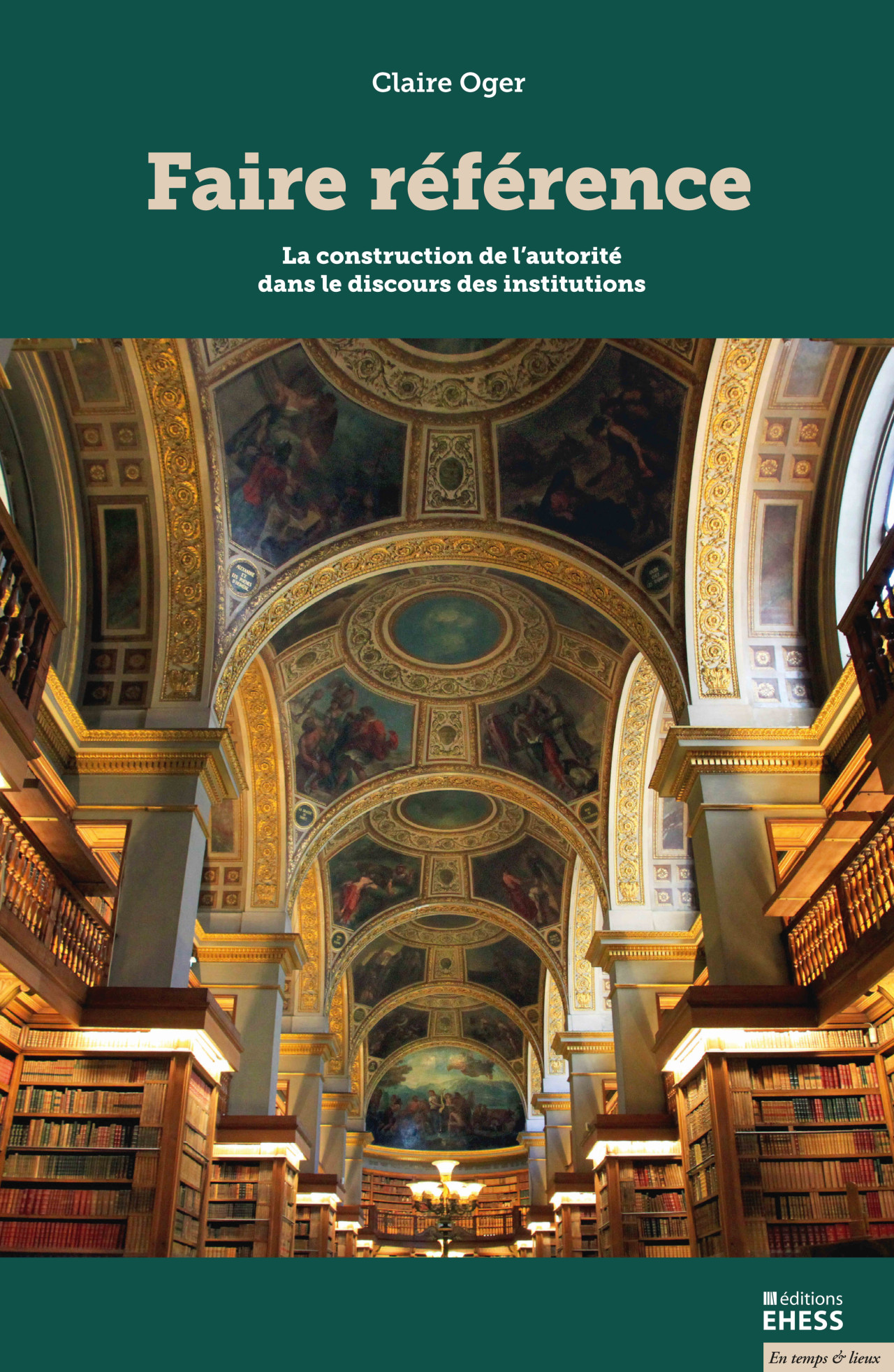
Faire référence
Claire OGERCollection
En temps & lieuxDate de publication
3 décembre 2021Résumé
De la rhétorique à l'analyse du discours, à la sociolinguistique ou à l'anthropologie de l'écriture, de l'Antiquité à l'époque contemporaine, en passant par les finesses de l'écriture médiévale ou les modalités de la citation, outils et concepts abondent pour analyser les ressources qui permettent de " faire référence " et de produire une parole ou un discours d'autorité. En les rassemblant, en les confrontant à des recherches menées en sociologie, en sciences politique ou en histoire, Claire Oger montre que les figures qui y sont attachées (du chef au fondateur) ou les positions qui y sont associées (pouvoir, domination) ne suffisent pas à caractériser les discours d'autorité. On ne peut pas non plus les comprendre ni les analyser sans dissocier l'autorité de l'autorit ...
Lire la suite
FORMAT
Livre broché
27.00 €
Ajout au panier /
